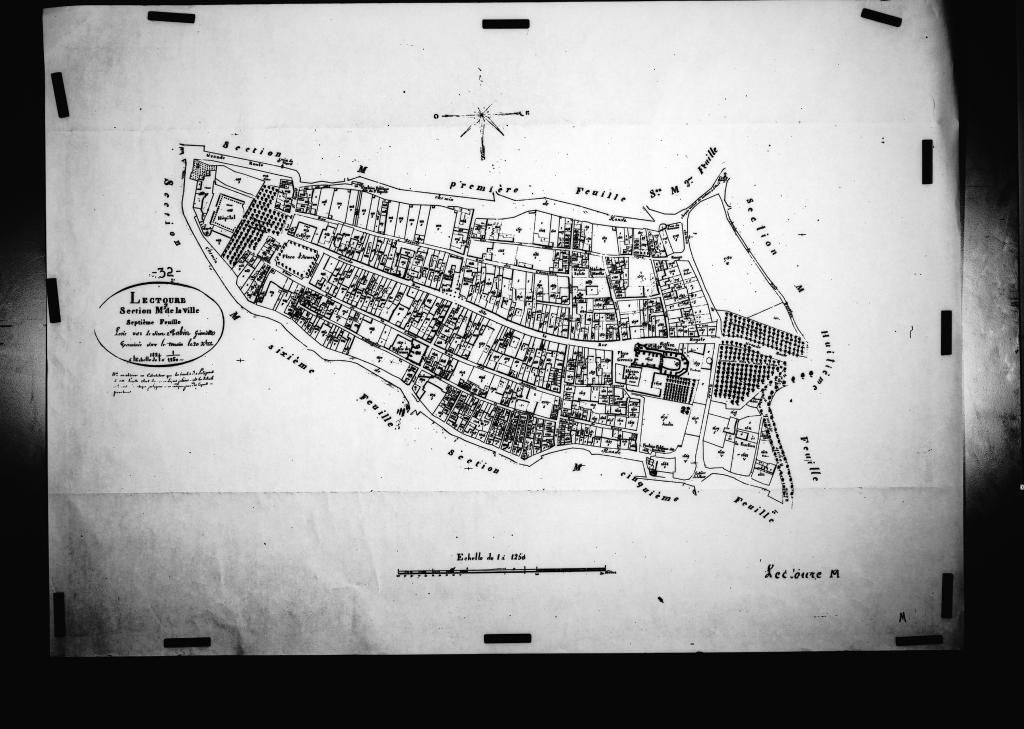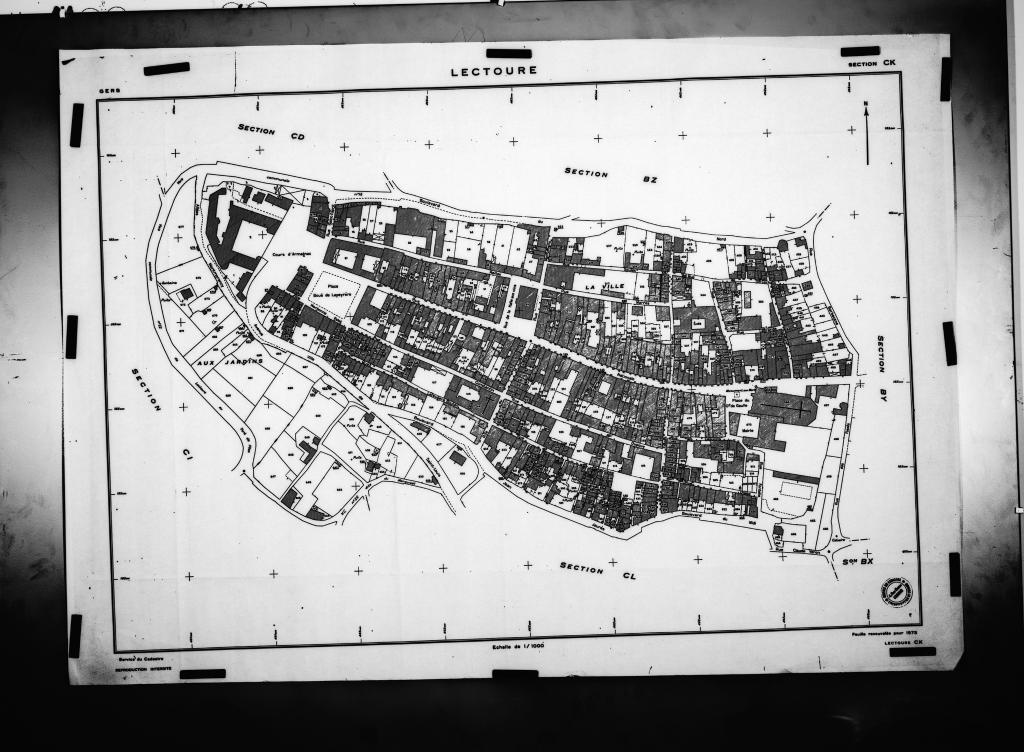Les vestiges retrouvés laissent penser que le site est resté occupé pendant toute la protohistoire. Un habitat gaulois fortifié a abrité la tribu des Lactorates qui pactisent avec la puissance romaine et établissent la ville de Lactora, qui devient chef-lieu d'une civitas de Novempopulanie au IIIe siècle. Cette époque correspond surtout au développement de la ville basse mais des vestiges à l'ouest de l'éperon atteste la présence d'un quartier de potiers. La vie publique se concentre sur l'éperon avec le forum et les temples. On a découvert au XVIe siècle dans les décombres de la cathédrale romane un ensemble de 22 autels tauroboliques, collection remarquable présentée au musée archéologique municipal. Quelques sculptures antiques en marbre en remploi sont remontées dans des maçonneries plus récentes. Dès la fin du IIIe siècle, la ville est troublée par les premières invasions franques : les habitants quittent la ville basse pour l'éperon qui est alors fortifié. Deux portions de rempart ont été m is au jour en 1976 et 2012.
Un évêque de Lectoure est mentionné en 506 comme participant au concile provincial d'Agde. A cette époque se développent les cultes de saint Geny et sain Maurin. Une chapelle préromane à l'est de la cité gallo-romaine est également le site d'une nécropole où 800 tombes ont été fouillées, dont d'admirables sarcophages. La cité aurait été ravagé par les Normands au IXe siècle. Lectoure devient la capitale de la vicomté de Lomagne vers 980. A partir du XIIe siècle, les droits sur le domaine de la ville sont partagés entre l'évêque Géraud de Monlezun et le duc d'Aquitaine, futur roi d'Angleterre Edouard Ier. Le style des parties les plus anciennes de la cathédrale est celui de la fin du XIIe siècle et la fontaine de Diane (ou Hountélie) date du début du XIIIe siècle. Cinq maisons situées impasse Péricer pourraient être les plus anciennes de la ville : l'une d'elle a été datée d'environ 1250 par dendrochronologie. En 1282 est reconstruite l'enceinte du IVe siècle.
Une ville prospère au 13e et pendant la première moitié du 14e siècle
Le style des parties les plus anciennes de la cathédrale est celui de la fin du XIIe siècle et la fontaine de Diane (ou Hountélie) date du début du XIIIe siècle. Cinq maisons situées impasse Péricer pourraient être les plus anciennes de la ville : l'une d'elle a été datée d'environ 1250 par dendrochronologie. En 1282 est reconstruite l'enceinte du IVe siècle.
De part et d'autres de la crête centrale qui traverse la ville, des parcelles en lanières ont été construites de hautes maisons datées par leur bois de la 2e moitié du 13 siècle et du 1er quart du 14e siècle. Elles se caractérisent par leur moyen appareil de maçonnerie soigneusement équarri. Elles s'apparentent pour certaines à des tours par leur hauteur et leur faible largeur, de 6, 30 m en moyenne. Certaines ont été réunies entre elles comme au 41-43 rue Nationale. Les premiers niveaux sont les plus élevés et les moins éclairés. Six de ces édifices, les plus somptueux, comportent au niveau inférieur un salle voûtée de 5 ou 6 m de haut, souvent divisée par un plancher. Seules deux baies géminées ont été recensées ; au XIVe siècle apparaissent les croisées. De nombreux éléments de conforts (lavabos, éviers, niches, placards muraux, latrines), mais seule la tour d'Albinhac a conservé ses cheminées. Seules les décors peints du 41 rue Nationale sont conservés. En 2016 a été découvert à l'est de la halle aux grains un puits (privé ou public), à la forme particulière en "trou de serrure".
De part et d'autre de la crête centrale, les pignons de ces maisons sont éloignés de 50 à 60 m soit une largeur excessive pour une rue. On suppose que dans cet espace des venelles et des échoppes prenaient place.
Cette période correspond également à l'installation des ordres religieux : Franciscains en 1282, Carmélites en 1289, Carmes sans doute au tournant du 13e siècle, Dominicains et Clarisses au début du 14e siècle. Plusieurs hôpitaux hors de l'enceinte complétaient l'hôpital principal du Saint-Esprit, intra-muros.
Le travail des peaux est attesté au faubourg d'Ydronne dès le 14e siècle. Les céréales de la juridiction étaient stockés dans de nombreuses fosses-silos en sous-sol dont on a retrouvé les ouvertures. Le grain était transformé dans les moulins à eau situés au pied de l'éperon comme le moulin Saint-Jourdain et le moulin de Belin, le mieux conservé.
La fin du Moyen Age, une période difficile.
La charte de coutume est rédigé en 1294. Jean Ier d'Armagnac hérite de la vicomté en 1325. A cette époque, la puissante maison d'Armagnac s'installe à Lectoure, mais le développement de la ville est ralenti entre 1330 et le milieu du XVe siècle, période de la peste noire et de la guerre de Cent Ans. La tour à l'arrière du n°10 de la rue des Capucins témoigne de la reprise de la construction au milieu du XVe siècle et conserve une remarquable cheminée exposant les armoiries du commanditaire qu'on retrouve côté rue, sur la console à l'angle sud-ouest.
La ville, qui relève de la maison d'Armagnac, est assiégée par le pouvoir royal à cinq reprises entre 1443 et 1472 avant l'épisode de 1473 qui voit, après la capitulation, l'assassinat de Jean V d'Armagnac et des massacres de population ; l'historiographie a exagéré sans doute les destructions car les données archéologiques ont répertorié 64 structures civiles médiévales et 52 immeubles en élévation. Mais seules la Tour Grande et celle d'Albinhac sont épargnées : murailles, cathédrale et château sont démolis ou incendiés.
Reconstruction et renaissance sous tutelle royale
Immédiatement après les destructions de 1473, la ville et seigneurie est donnée par Louis XI à Bertrand d'Alègre, seigneur de Busset, à condition de réparer et fortifier la ville. En 1474, le roi exempte les habitants de toute imposition et de l'entretien des gens de guerre pour une durée de 7 ans (elle sera prolongé de 50 ans). La sénéchaussée d'Auch est transférée à Lectoure et un présidial, tribunal civil et criminel est établi en 1552.
En 1477, l'arrivée de Mathieu Reguaneau, architecte originaire de Touraine, marque le début de la reconstruction de la cathédrale qui se poursuit pendant la majorité du 16e siècle Trop proche des murailles, le couvent des Carmes est détruit par Jean V d'Armagnac qui anticipe le siège mais donne à l'ordre des terrains près de l'hôpital intra-muros ainsi qu'une rente pour la reconstruction, à laquelle son assassinat met un terme.
Au début du 16e siècle, la ville de Lectoure est aussi importante qu'Auch avec au moins 4 000 habitants. L'église des Carmes est agrandie en 1537 (inscription sur le maître autel) et on lui adjoint en 1541 l'hôpital du Saint-Esprit. Le Collège est fondé peu après 1556. Les analyses dendrochronologiques démontrent les nombreuses reconstructions de maison entre 1489 et 1531. Les édifices conservent trace des interventions de cette période : croisées, style des cheminées et des décors.
Cette époque du début du 16e siècle voit également la reprise et la modernisation des défenses de la ville. De cette campagne date la tour de Corhaut (1537).
La ville est touchée par les soubresauts des guerres de religion, ce qui suscite des destructions à la cathédrale encore en travaux et dans plusieurs couvents. Fin septembre 1562, Blaise de Monluc, général du roi, s'empare de Lectoure au détriment du chef des protestants Symphorien de Durfort, vicomte de Duras.
En 1594, on réhabilite une ancienne salle médiévale pour y créer une maison commune. Le chantier de la cathédrale reprend. En 1630 est fondé le Collège des Doctrinaires. Les fondations de couvent dans le cadre de la Contre-Réforme se multiplient : Notre-Dame du Chapelet en 1575, couvent des Capucins en 1630, nouveau couvent des clarisses en 1617, Carmel en 1623 fondé par le maréchal de Roquelaure. Les carmélites de Lectoure ont développé très haut la fabrication d'ornements liturgiques dont témoigne l'ensemble du trésor de la cathédrale. Le couvent des Dominicains est reconstruit en 1626. L'hôpital du Saint-Esprit, déplacé est également reconstruit en 1659. Jugeant son évêché trop modeste, l'évêque Hugues de Bar fait édifier entre 1676 et 1682 un somptueux palais épiscopal.
L'habitat est aussi l'objet de reconstruction au 17e siècle, avec de grandes maisons sur la rue Royale et plusieurs hôtels particuliers qui témoignent de l'aisance des élites de la ville.
Une nouvelle ville au 18e siècle
Deux grands projets de construction marquent la période : la grande tannerie des frères Duclos,qui reçoit en 1754 le titre de manufacture royale et l'hôpital-manufacture à partir de 1759, à l'initiative de l'évêque Claude François de Narbonne-Pelet.
Les travaux urbains effacent la ville médiévale : la place de la cathédrale est aérée (les embans, auvents le longs des maisons sont supprimés), des ormeaux sont plantés sur les cours et l'on aménage une vaste esplanade devant le château pour le foirail. L'ordonnance du 18 mars 1740 ordonne que les rues soit réparées, pavées ou gravelées et soient élargies et alignées. Les fossés sont convertis en jardins particuliers.
De nombreuses maisons à l'architecture classique bordent désormais la rue Royale dans un ensemble très homogène. Treize élévations ont été repérées sur cet axe, avec une porte unique à battants symétriques au centre d'une large façade, comme au n° 88 ou au 134-138. La pierre de taille en façade remplace les pans de bois dont subsistent seulement les têtes maçonnées, notamment du côté impair de la rue qui offre à l'arrière la vue sur la vallée du Gers et les Pyrénées. Les reconstructions ne concernent parfois que la façade. Leur sobriété masque la richesse des aménagements intérieurs. Des hôtels particuliers sont encore construits comme l'hôtel Descamps, le vaste hôtel de Goulard et l'hôtel Bastard-Castaing.