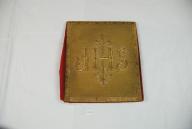Une église dépendant de l’abbaye de Quarante est mentionnée au 10e siècle, à l’occasion d’un « jugement de Dieu » tenu en 902. Au 14e siècle, la paroisse est suffragante de l’abbaye de Saint-Chinian. L’église Sainte-Eulalie a été construite hors et au nord du village dont les premières maisons se trouvaient à quelques dizaines de mètres, au-delà du premier cimetière installé au pied de l’édifice. C’est dans un second temps qu’elle est intégrée dans le périmètre défensif pour servir de donjon sur le flanc nord.
A l’est, le mur-diaphragme ne semble pas lié à l’arc doubleau qui renforce la voûte en berceau brisé. A l’extérieur, on voit nettement la double ligne rampante d’un ancien toit. Le mur est ajouré par une rose ornée d’une étoile de David polylobée, plus petite et d’un diamètre de 2 m. Elle porte, gravées sur le parement extérieur de l’encadrement, les dates de 1591 et de 1697 qui correspondent probablement à des travaux, peut-être des réfections de toiture. En dehors de la façade occidentale et du mur-diaphragme déjà évoqués, les autres vestiges pouvant appartenir à un édifice antérieur ne sont pas nombreux : la base du clocher au-dessous de l’étage campanaire et la base du mur gouttereau nord correspondant aux deuxième et troisième travées. Dainville identifie ce mur avec celui d’un collatéral ainsi que le croisillon du transept tous deux d’époque romane, mais la réalité semble plus complexe. La présence d’un croisillon reste à démontrer et, si la base du clocher appartient bien à un édifice antérieur, on peut voir, à l’extérieur, que son appareil n’est pas chaîné à celui du mur gouttereau dans la deuxième travée. La base du mur gouttereau de cette travée appartient donc à un état intermédiaire. Les deux premières travées sont plus larges que les autres, qui ont la même largeur que le clocher. Le berceau brisé, qui couvre les deux dernières travées est certainement construit vers la fin du 13e siècle. Les première et deuxième travées sont rebâties un peu plus tard, à l’identique, au début du 14e siècle, en même temps que le chœur mais les courbes des arcs doubleaux sont plus maladroites. Les arcs doubleaux et les colonnes engagées sont semblables mais les moulurations des bases prismatiques des nouvelles colonnes sont plus sommaires. On note également un changement de l’appareil de la voûte, véritable remaillage de lits de hauteurs différentes, le long du doubleau séparant les deuxième et troisième travées, qui prouve que le berceau brisé n’a pas été bâti d’un seul jet. Pour contrebuter la poussée de la nef couverte en berceau brisé, les contreforts sont construits et surélevés : on lit très bien leur insertion dans les parties basses des murs gouttereaux alors que les assises sont liées plus haut. L’extrados de la voûte est protégé par une couverture de dalles disposées en escalier, un clocheton de style roman couronnant le faîtage. La construction de l’étage campanaire est contemporaine de la campagne du 14e siècle. La base du clocher est formée d’un noyau maçonné plein, dans lequel s’insère l’escalier en vis éclairé par des ouvertures étroites, sortes de meurtrières trop peu hautes pour servir de postes de tir.
Peu de temps après ces travaux, peut-être vers le milieu du 14e siècle, l’église est fortifiée sur trois côtés. Peu de temps après, le mur d’enceinte du village vient l’englober dans le périmètre de défense. Des mâchicoulis sur arcs sont installés entre les contreforts tout autour de l’église, à l’exception de la façade ouest : l’ancrage des arcs des mâchicoulis dans les contreforts brouille l’ordonnance de l’appareil. La modénature des arcs surbaissés, aux arêtes chanfreinées, s’avère atypique et donc difficilement datable quand les exemples comparables ne comportent que des angles pleins. Un parallèle peut être fait avec la collégiale de Clermont-l’Hérault où l’insertion des arcs a perturbé fortement les assises des contreforts mais ils ne comportent aucun chanfrein. Un seul indice chronologique permet de confirmer la datation proposée : le mâchicoulis nord de la dernière travée avant le chœur, à l’angle du clocher, a été démonté pour construire « l’ancienne sacristie » au 15e siècle. Faut-il rattacher à cette fortification générale de l’édifice la construction du système de mâchicoulis sur consoles encorbellées qui protège le porche méridional, ainsi que les échauguettes qui somment les contreforts ? Ces aménagements sont-ils plus tardifs ? Pour Dainville et pour Hyvert, la fortification du porche est un ajout du 16e siècle, contemporain des troubles des guerres de Religion.
Si cela est avéré, il s’agit d’un véritable archaïsme, ce mode de défense étant abandonné depuis longtemps avec la généralisation des armes à feu. Enfin, aucune trace de démontage d’un arc de mâchicoulis ne se voit dans la maçonnerie du porche. Pour conclure, le soin apporté à la construction dément un aménagement réalisé à la hâte. La disposition des consoles sur plusieurs rangs est une pratique courante depuis le début du 14e siècle, tant dans l’architecture militaire développée par les architectes du roi de France que dans les nouvelles fortifications construites pour les papes en Avignon. Localement, on peut rapprocher cet aménagement des mâchicoulis sur consoles présents sur la façade ouest de la collégiale de Clermont-l’Hérault, de ceux qui surmontent le porche de l’église de Montagnac - même si la modénature des consoles y est plus fouillée - ou encore de ceux du contrefort nord de la façade de l’église de Servian. En ce qui concerne les échauguettes circulaires, la question n’est pas tranchée avec certitude mais on peut noter que celle qui surmontait le contrefort de l’absidiole nord du chœur a été démontée lors de la construction de « l’ancienne sacristie » au 15e siècle. On retrouve des aménagements assez semblables sur d’autres églises languedociennes, au clocher de l’église de Caux par exemple, aux angles de la chapelle latérale de l’église de Saint-Félix-de-Lodez ou encore à Montagnac, sur les angles du bas-côté méridional, de part et d’autre du porche. On y voit clairement l’incrustation des consoles dans la maçonnerie du mur gouttereau, mais les éléments de datation font cependant défaut. Les derniers aménagements conséquents concernent la construction des chapelles latérales entre les contreforts, deux au nord, trois au sud, l’aménagement du porche méridional, la construction de petits locaux destinés à la confrérie du Saint-Sacrement et à l’œuvre Sainte-Eulalie et enfin une sacristie. Les trois chapelles latérales au sud, celle qui abrite le baptistère au nord et celle qui flanque le clocher ainsi qu’une pièce voûtée d’ogive, appelée « ancienne sacristie », entre cette chapelle et l’absidiole nord, sont édifiées au 15e siècle. Le percement des chapelles se lit très bien dans les reprises des maçonneries. Les chapelles sont couvertes de voûtes sur croisées d’ogives effilées en cavets. A l’extérieur, les couvertures des voûtes sont installées sous les arcs des mâchicoulis, rendant leur rôle défensif obsolète. Dans la troisième travée, la chapelle est surmontée d’une nouvelle voûte en plein-cintre qui vient affleurer le parement externe des contreforts, condamnant ainsi le mâchicoulis sur arc qui subsiste en sous œuvre.