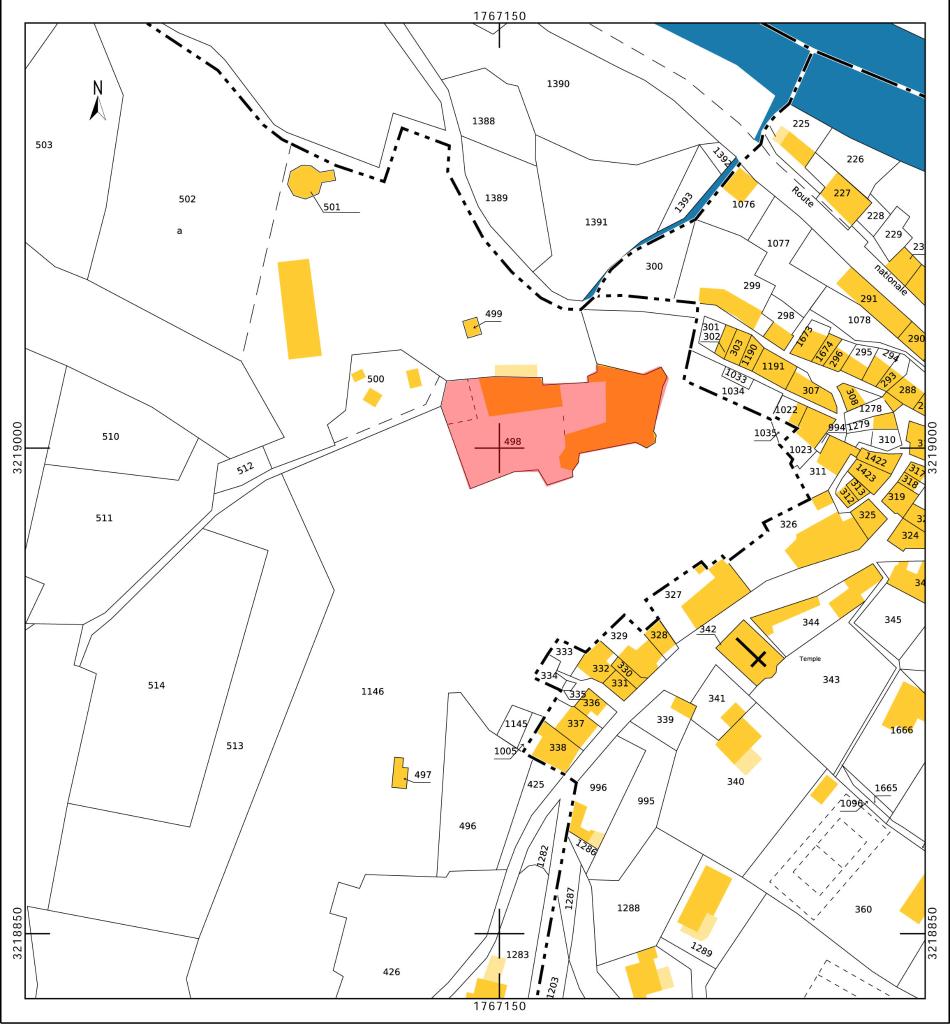Le château de Cambiaire domine le village de Saint-Étienne. Repérable à ses tours et ses deux cèdres remarquables émergeant dans le paysage, le château a été édifié au cours du 14e siècle par les de Raymond. D’après les sources écrites, Bernard et Pierre de Raymond, seigneur de Saint-Germain, auraient obtenu du vicomte de Beaufort, en 1366, l’autorisation de construire un édifice fortifié muni de tours, de tourelles et de créneaux à Saint-Étienne. Puis en 1392, ils acquièrent le droit de justice et les droits seigneuriaux de la part de Bernard Pelet, baron d’Alès. Le compoix de 1590 indique qu’Anthoine de Cubellis, alors seigneur de Saint-Étienne, possède un « chasteau audit lieu de St Estienne en quadrangle, à trois tours rondes au flanc, de trois quarrés et aultre haulte et grosse tour carrée à laultre coing, servant de donjon audit chasteau ». Cette description correspond au château actuel.
Le château adopte son patronyme actuel de Cambiaire en 1789, lorsque le marquis de Cambiaire épouse l’héritière de la famille. Il fait l'objet de très grands travaux au cours du 3e quart du 19e siècle sous l'impulsion de la marquise Jeanne de Cambiaire, ce qui lui confère un aspect néogothique dominant. Elle remodèle complètement les façades et fonde la chapelle ainsi que la grotte au bas du parc. Elle introduit des espèces exotiques comme les cèdres, séquoias, bambous, palmiers, ormes du Caucase encore visibles dans la cour du château.
Lors de la seconde Guerre mondiale, le château est incendié par les troupes allemandes en avril 1944 en représailles contre l’assassinat de trois soldats allemands par les maquisards de Bir-Hakeim, basés à la Picharlerie (Sainte-Croix-Vallée-Française). Le dernier propriétaire du château, le baron François du Sart de Molembaix, décède en 1963, après quoi le lieu est laissé à l’abandon. Racheté en 2019 par les propriétaires actuels, le château est restauré afin de lui rendre son cachet originel et le convertir en lieu d’accueil.
Le château a obtenu, en 2023, le financement de la fondation Bern pour assurer la restauration du donjon et de la chapelle.