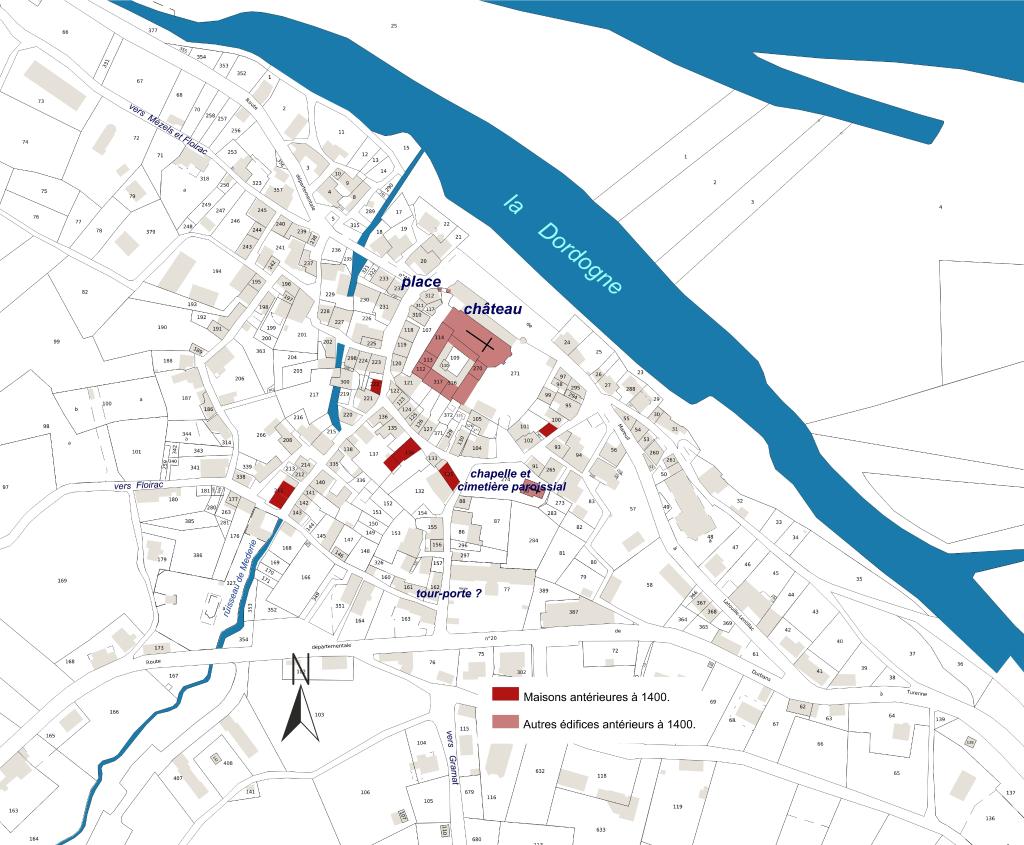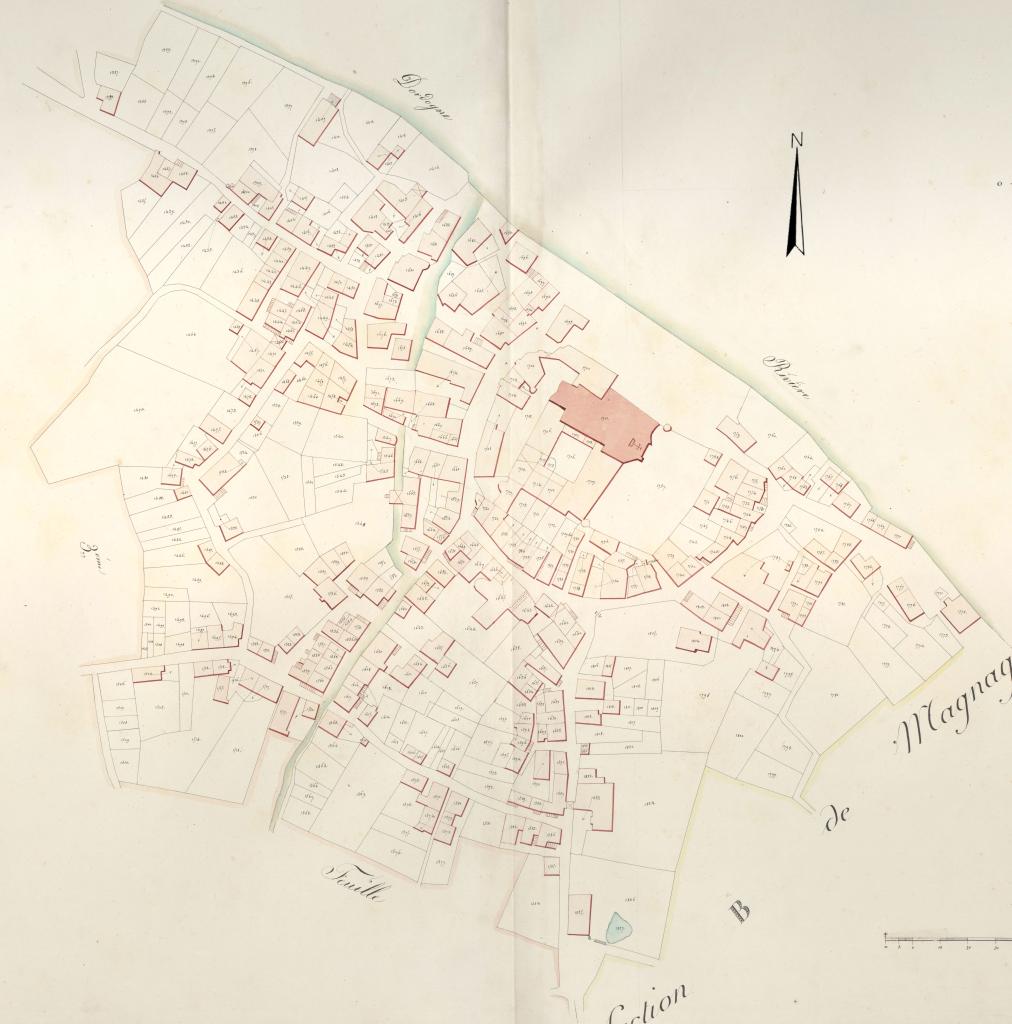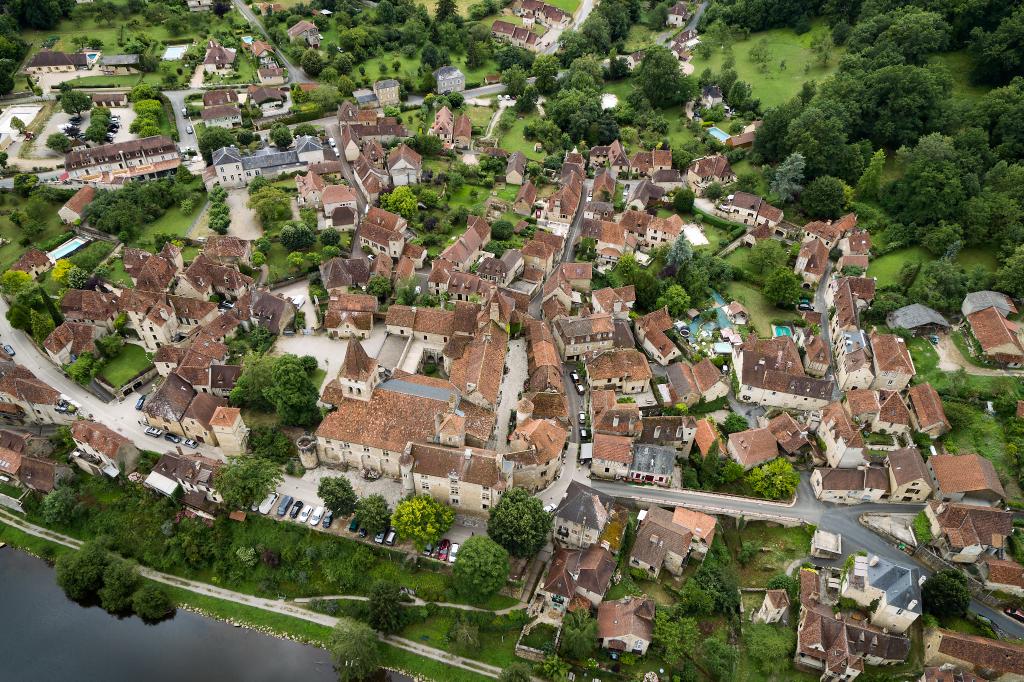En 932, après avoir pris l'avis de Raimond, comte de Toulouse, de Rouergue et de Quercy, le vicomte de Cahors Frotard et son épouse Adalbergue donnèrent à l'abbaye de Beaulieu de nombreux manses et églises qu'ils possédaient en propre, dont certains près de la Dordogne, à Saint-Sozy, Meyronne, Floirac... ainsi que l'église Saint-Saturnin Évêque, avec ses appartenances, située dans le « vicus » de Carennac où existait donc déjà un groupement d'habitations. Soit que la donation ait été contestée, soit qu'il ait été procédé à des échanges, aucune de ces donations ne demeura à l'abbaye de Beaulieu, et l'église Saint-Saturnin de Carennac était possédée au milieu du 11e siècle par l'Église de Cahors, quand l'évêque la donna à l'abbaye de Cluny (E. Albe, A. Viré, 1912, p. 541, 545). Le prieuré Saint-Pierre érigé sur le territoire de la paroisse obtint en 1175 une bulle qui le plaça sous la protection du pape, ainsi que la « villa », les terres, les eaux et le port du lieu, et ses nombreuses autres possessions (E. Albe, A. Viré, 1912, p. 556).
Carennac relevait au 13e siècle de la baronnie de Gramat et a fait partie à ce titre des lieux pour lesquels Hugues de Castelnau faisait hommage au comte de Toulouse Alphonse de Poitiers en 1259 ; le prieur devait à son tour l'hommage au seigneur de Castelnau, auquel l'arbitrage de 1265 ne reconnut cependant que la possession de la moitié de la basse justice, pour laquelle il fut convenu qu'il recevrait 10 livres de rente annuelle et une paire d'éperons dorés pour droit d'acapte (E. Albe, A. Viré, 1912, p. 562) : le prieur, puis le doyen à partir de la fin du 13e siècle, était de fait le seul seigneur de la ville et de ses habitants.
Le monastère était incapable de s'acquitter des taxes pontificales en 1360 et, comme toutes celles du pays de Gramat, la paroisse de Carennac fut réputée déserte en 1370. On se souvenait en 1409 que les habitants avaient voulu abandonner les lieux en raison des guerres et des pestes, et ceux qui y étaient demeurés ou qui y étaient revenus s'opposèrent aux redevances jugées exorbitantes qu'exigeaient les religieux, en les menaçant à nouveau de s'exiler (E. Albe, A. Viré, 1912, p. 591-592 ; A.-M. Pêcheur, 1988, p. 22).
C'est à l'occasion d'un nouveau conflit avec les moines qu'apparaissent en 1477 les syndics de la communauté et la mention d'une ancienne charte de coutumes dont nous ne connaissons ni la date, ni le contenu, mais qui n'était peut-être guère plus avantageuse que la nouvelle charte octroyée après arbitrage. Les habitants ont au moins obtenu l'annulation des règlements édictés par le doyen au mépris de leurs coutumes, et ont retrouvé, entre autres, pour leurs seuls besoins personnels, le droit d'avoir une barque et celui de prendre du bois et des pierres pour la construction... Les syndics n'ont aucun pouvoir même partagé et ne jouissent d'aucune autonomie : aux siècles suivants, il semble qu'ils n'aient eu que la peu enviable charge de répartir la taille.
Eléments repérés : maison (parcelle 2006 AE 261), pan-de-bois 15e-16e siècle (?) ; maison (parcelle 32), croisée ; maison (parcelle 29), petite fenêtre carrée sur pignon, pan-de-bois sur l'élévation arrière, porte à linteau chanfreinée et porte en plein cintre chanfreinée, 16e siècle (?) ; maison (parcelle 102), porte chanfreinée à linteau, jour chanfreiné, bolet, appui saillant du 15e siècle sur une fenêtre de l'élévation latérale ; maison (parcelle 101), croisée bâtarde à baguettes croisées ; maison (parcelle 104), jour à accolade à l'étage ; maison (parcelle 124), vestiges d'une porte chanfreinée à linteau à accolade, jour en meurtrière, 2e porte chanfreinée, petite fenêtre chanfreinée à l'étage ; maison (parcelle 122), étal et demi-croisée en façade, escalier extérieur et porte haute à linteau à accolade sur l'élévation latérale, poutre de la cheminée apparente ; maison (parcelle 225), jour à accolade ; maison (parcelle 226), départ d'un arc ; maison (parcelle 228), porte basse en plein cintre (16e siècle), porte haute chanfreiné ; maison (parcelle 223), porte basse segmentaire chanfreinée, à l'étage croisée, demi-croisée (?) et croisée bâtarde ; maison (parcelle 224), vestige d'arc ; maison (parcelle 214), linteau à accolade et boutons ; maison (parcelle 220), petite fenêtre à double cavet et accolade ; maison (parcelle 221), croisée bâtarde sur rue et petite fenêtre latérale ; maison (parcelle 162), porte à piédroit en quart de rond et linteau à gorge et accolade ; maison (parcelle 138), porte haute chanfreinée sur l'élévation latérale ; maison (parcelle 137), portail chanfreiné à linteau sur coussinets ; maison (parcelle 93), porte basse en plein cintre chanfreinée et petite fenêtre moulurée, 16e siècle ; maison (parcelle 83), à l'étage porte à piédroit en quart de rond et linteau à gorge, croisée, escalier extérieur ; tour d'escalier (parcelle 289), porte à décor de baguettes croisées et vestiges d'une cheminée datée 154. ; maison (parcelle 9), porte à piédroits en quart de rond et linteau à gorge, jour chanfreiné ; maison (parcelle 238), piédroit à coussinet et fragment de linteau en bois chanfreiné, sur l'élévation sud linteau et poteau en bois chanfreinés ; maison (parcelle 237), balcon à croix de Saint-André, appui à mi-bois sur les poteaux chanfreiné ; maison (parcelle 341), linteau à festons en remploi ; maison (parcelle 357), croisée bâtarde ; maison (parcelle 253), croisée bâtarde.