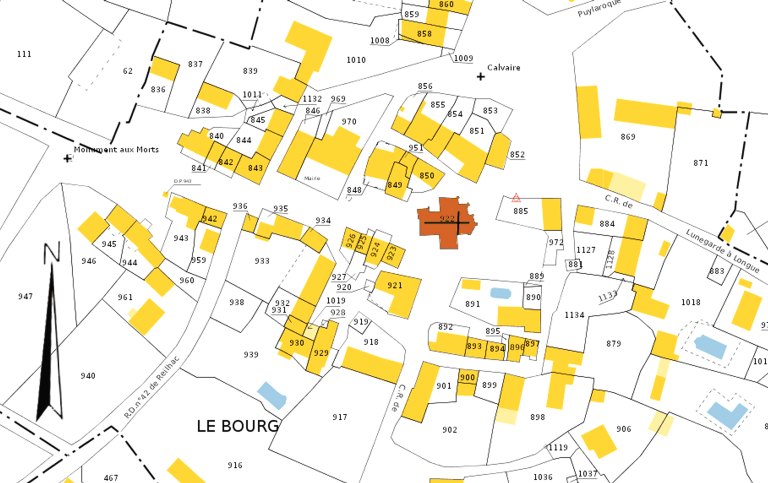La tradition (Les petits Bollandistes, op. cit.) veut que l'église possède un fragment de la vraie croix et une relique insigne, le saint bandeau, une bande de toile dont les yeux du Christ auraient été couverts alors qu'on le souffletait dans la maison de Caïphe, qui aurait attiré de nombreux pèlerins avant la Révolution. La relique, donnée par Charlemagne à l'abbaye de Marcilhac alors restaurée par saint Namphase, aurait été transportée à Lunegarde, à une époque indéterminée : peut-être avant 1468 selon Les petits Bollandistes, ou en 1569 lors du sac de l'abbaye par les protestants, ce qui est peut-être plus probable (V. Rousset, op. cit.). L'architecture de l'église, en tout cas, ne traduit pas la présence d'une relique aussi importante. Le reliquaire du 13e siècle qui contient le saint bandeau est aujourd'hui conservé au musée d'art sacré de Rocamadour.
Dédiée à saint Julien de Brioude, l'église aurait appartenu de tout temps à l'abbaye de Marcilhac, dont le chantre était prieur de Lunegarde qu'il faisait desservir par un vicaire (Clary, 1986). L'état le plus ancien de l'édifice peut dater de la fin du 12e siècle ou de la première moitié du 13e. C'est pendant la guerre de Cent ans ou bien lors d'une reconstruction très importante qui serait survenue au début du 16e siècle qu'il faudrait placer la surélévation de la nef et de l'abside, destinée à servir de refuge, en tout cas avant la construction de la chapelle sud car la bretèche devait protéger une porte, qui a donc disparu. La voûte de l'abside peut dater de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle, et appartiendrait à la campagne de travaux qui a vu la réalisation du décor peint. Les deux chapelles sont plus tardives et, en dépit de la similitude des profils des nervures et des clefs de voûte avec ceux de l'abside, ne sont probablement pas antérieures à la fin du 16e siècle, voire le début du 17e siècle. Le dessin du portail ouest incite à dater du 19e siècle la reconstruction de la façade occidentale et le clocher. Les vitraux sont signés et datés Echaniz, 1975, Toulouse.