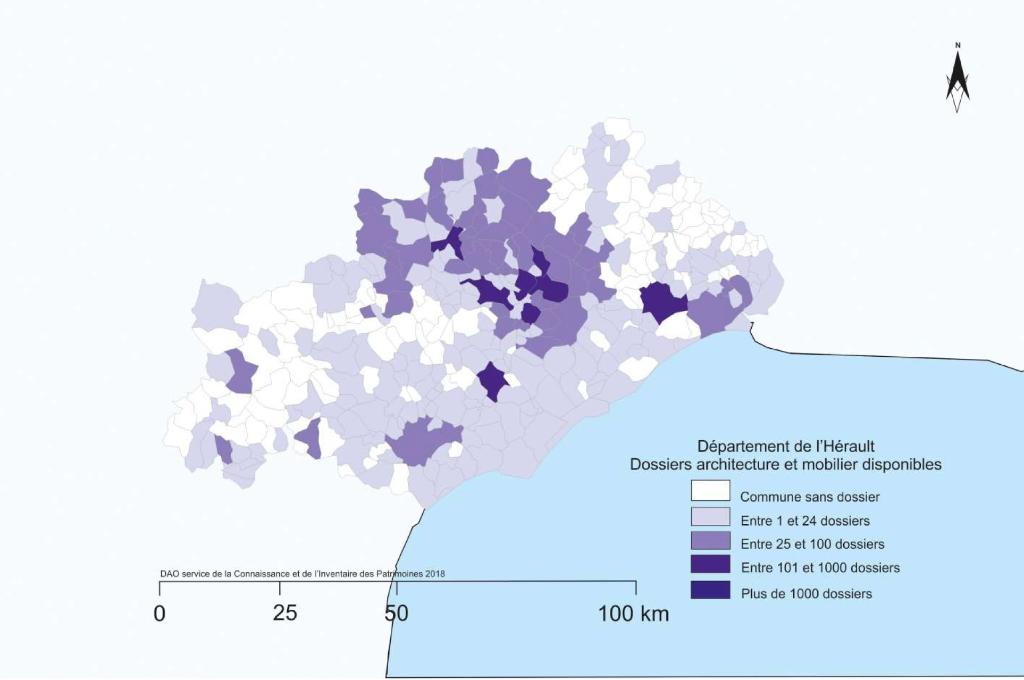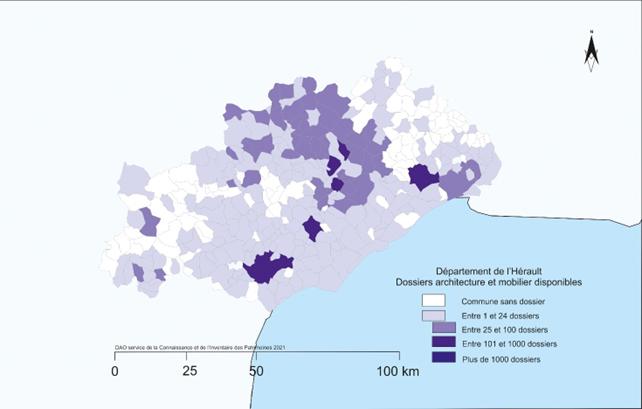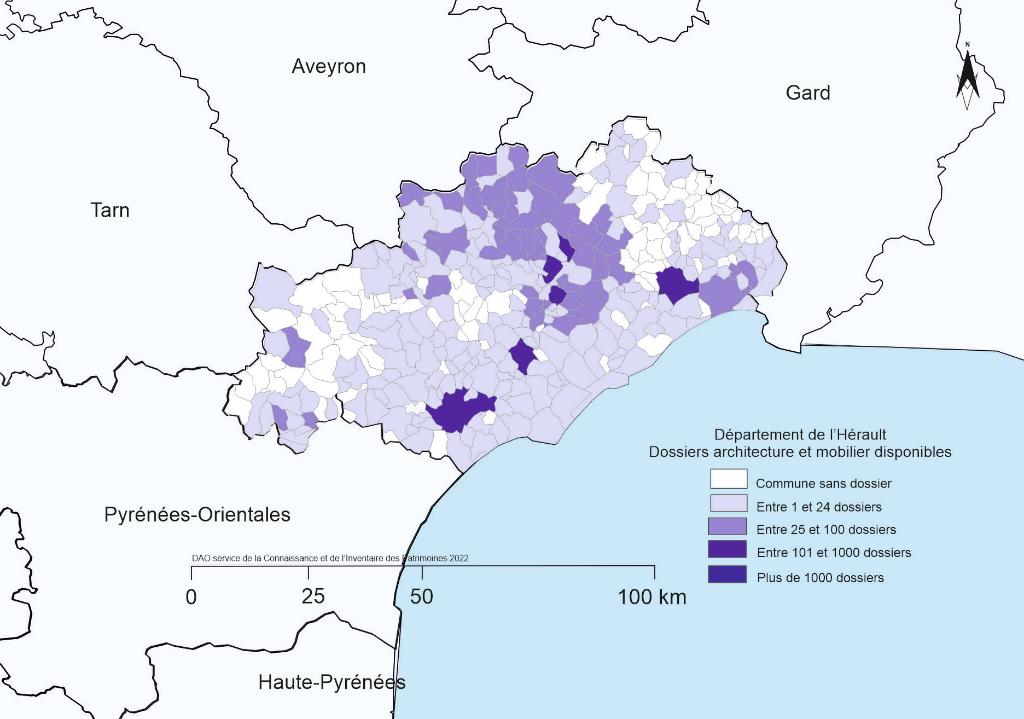Quelques années après la création de commission régionale de Languedoc-Roussillon en 1965, démarrèrent les premières opérations d'inventaire topographiques sur les communes proches de la Méditerranée. Elles étaient destinées à seconder la mission interministérielle, dite « Racine », d’aménagement du littoral languedocien, et ont permis de constituer les premiers dossiers d'inventaire sur le département.
Les équipes de recherche détachées sur place s’intéressent dès 1965 à l’architecture urbaine, en particulier celle de Montpellier, étudiée par Ghislaine Fabre, Marie-Sylvie Grandjouan, Thierry Lochard, Jean Nougaret, Bernard Sournia, Jean-Louis Vayssettes et Bernard Sournia qui publient deux ouvrages de référence : Montpellier, la demeure médiévale (1991) et Montpellier, la demeure classique (1994).
A partir de 1971 plusieurs opérations de pré-inventaire sont menées sur les cantons de Béziers, Bédarieux, Castries, Florensac, Frontignan ou encore Agde. Les enquêtes ont permis de constituer quelques dossiers d'inventaire et une importante documentation préalable aux enquêtes futures dont l'essentiel est conservé au centre de documentation du patrimoine de Montpellier.
A la même époque, les cantons de Maugio et de Gignac bénéficiaient d'un inventaire fondamental tant pour l'architecture que pour le mobilier. 588 dossiers architecture et 1.230 dossiers objet ont été constitués et versés sur les bases nationales. Plusieurs publications ont permis de diffuser les résultats de ces enquêtes : Le Pouget : Hérault, sous la direction de Jean-Louis Libourel, 1993 et Gignac : un canton de la moyenne vallée de l'Hérault., par Hélène Palouzié, 1992.
En 1983 et 1987, un inventaire topographique du canton de Clermont-l'Hérault, qui couvrait alors les communes de Aspiran, Brignac, Canet, Celles, Ceyras, Clermont-l’Hérault, Lacoste, Liausson, Mourèze, Nébian, Paulhan, Saint-Félix-de-Lodez, Salasc, Valmascle et Villeneuvette est engagé, mené par Francine Arnal et Marie-Sylvie Grandjouan qui traitent essentiellement de l'architecture. Les objets du territoire seront étudiés quelques années plus tard par Hélène Palouzié. Une publication de synthèse sur ce secteur, dirigée par Francine Arnal, paraît en 1988 : Clermont-l'Hérault et son canton : Hérault.
En 1994, une enquête thématique sur la sculpture monumentale de la IIIe République, menée par Bernard Derrieu à l'échelle du Languedoc-Roussillon, a permis de repérer 307 monuments qui ont chacun un dossier.
L'inventaire du patrimoine industriel de l'Hérault a été réalisé, entre 2010 et 2015 (Lisa Caliste, Ondine Vièque), suivant la méthodologie élaborée par le ministère de la Culture se rapportant au patrimoine industriel pour répondre à l’inquiétude née de la disparition progressive du paysage industriel français (pour plus de détails, consulter le dossier de présentation de l’opération d’inventaire du patrimoine industriel de l’Hérault : IA34006076). Précédemment, plusieurs études ponctuelles avaient été menées sur ce territoire : entre 2005 et 2008, un inventaire du patrimoine industriel de Lodève (Michel Wienin), entre 2009 et 2010, un inventaire des distilleries coopératives de l'Hérault (Lionel Rodriguez et Sabine Normand), entre 2010 et 2011, un inventaire du patrimoine minier de l'ancien bassin houiller de Graissessac (Lisa Caliste). L'inventaire du patrimoine industriel de l'Hérault s'est poursuivi sur des thèmes et des échelles particuliers : en 2015, une étude sur l'industrie lainière à Lodève, Clermont-l'Hérault et Bédarieux (Lisa Caliste) ; entre 2015 et 2017, l'inventaire du patrimoine industriel de la commune de Bédarieux, en partenariat avec l'association bédaricienne Résurgences (Lisa Caliste). Depuis, des dossiers ponctuels sont ouverts (confiserie d’olives de Saint-Jean-de-Fos, mines d’uranium de la COGEMA au Bosc). A ce jour, 243 dossiers concernant le patrimoine industriel de l’Hérault sont constitués et près de 117 sont en ligne.
En 1999, une enquête thématique régionale sur les églises gothiques méridionales du Bas-Languedoc menée par Adeline Béa a repéré 24 édifices sur le département qui ont tous fait l'objet d'un dossier. L'année suivante commençait un inventaire thématique autour des mazets de Bédarieux mené par Adeline Béa et Xavier Fernbach, achevé en 2003 alors que Jean Nougaret finalisait l'inventaire topographique des communes de Pézenas, Saint-Thibéry et Nézignan-l'Evêque engagé 6 ans auparavant. Son enquête a permis la rédaction de 79 dossiers d’édifices qui sont presque tous en ligne.
Entre 2002 et 2011, l'inventaire des communes de Capestang, Cessenon-sur-Orb, Laurens, Murviel-lès-Béziers, Saint-Chinian et Thézan-les-Béziers était complété par Jean-Michel Sauget, Adeline Béa et Sophie Clarinval dans le cadre de l'élaboration de la charte intercommunale des Coteaux de l'Orb et du Vernazobres.
A partir de 2008, une étude thématique sur les coopératives vinicoles et les distilleries est conduite à l'échelle de la Région Languedoc-Roussillon. Lionel Rodriguez et Sabine Normand recensent 09 distilleries dont seuls quelques dossiers sont en ligne. Il est rapidement décidé d'étendre l'enquête au patrimoine viticole du département. Dans un premier temps, ce sont les caves et distilleries coopératives du département qui ont été étudiées avec constitution de 137 dossiers et publication d'un ouvrage de synthèse : Caves et distilleries coopératives en Languedoc Roussillon, réunissant les travaux de toute l'équipe est publié en 2010. Dans un second temps l'étude des châteaux viticoles de l'Hérault (1850-1950) : architecture, décor, jardins était mise en route. Natacha Abriat, Dominique Ganibenc et Lionel Rodriguez ont assuré l'enquête de terrain. Les dossiers sont en cours de rédaction.
Depuis 2010 est engagée une enquête thématique sur les textiles anciens et les ornements liturgiques. Menée par Josiane Pagnon, elle a permis de repérer 64 œuvres pour la ville de Pézenas (voir dossier IA34008506), 122 pour l'évêché de Montpellier (voir dossier IA34008503), 90 pour Lodève (voir dossier IA34008501). Des opérations ponctuelles ont été menées sur le territoire de la communauté de communes du Lodévois-Larzac et un inventaire complet du patrimoine mobilier des églises des communes a été réalisé par Josiane Pagnon, complétant ainsi le pré-inventaire du patrimoine mobilier, amorcé en 1993.
A la même époque, une enquête thématique sur les ouvrages de franchissement du canal du Midi était mise en place, conduite par Jean-Michel Sauget avec la collaboration de Sabine Normand. Elle a pour l'instant permis de constituer 14 dossiers "architecture dans le département. Cependant, complétée d'une étude du patrimoine mobilier des communes bordant l'ouvrage d'art, elle a permis d'étudier en détail celui de la commune de Cruzy (voir dossier IA34008505) publiée en 2013 : Cruzy, entre vignes et canal par Jean-Michel Sauget et Josiane Pagnon, 105 pages.
En 2013, le recensement des vitraux anciens du département opéré en collaboration avec le Centre André Chastel a permis de repérer 18 verrières ou éléments de verrières datant de l'Ancien Régime. L'année suivante, la documentation patrimoniale du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc faisait l'objet d'une mise en conformité pour intégrer les bases de données de l'Inventaire général. 263 dossiers validés ont été mis en ligne.
Entre 2014 et 2018, une enquête thématique complémentaire sur les monuments aux morts remarquables du département signalait 9 édicules sur le territoire et a permis de proposer la protection au titre des monuments historiques de certains d'entre eux. Au sein du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles, l’inventaire de l’architecture du thermalisme de Lamalou-les-Bains a été engagé en 2018 par Julia Desagher. 29 dossiers d’œuvre ont été constitués.
Depuis 2019, en collaboration avec l'Association internationale de Recherche sur les Charpentes et Plafonds Peints Médiévaux, un inventaire des plafonds peints médiévaux est entrepris. Plusieurs dossiers sont constitués mais ils n'ont pas encore été mis en ligne.
Sollicité en 2019 par la CRMH Occitanie, elle-même sollicitée par l’association Casteln’au Vert, le service a mené une étude sur les puits, puits à roue et norias du quartier Notre-Dame-de-Sablassou, sur la commune de Castelnau-le-Lez. 50 aménagements hydrauliques ont été repérés, dont 12 puits à roue et norias ; 17 dossiers ont été constitués. Dans le prolongement de l’opération menée à Castelnau-le-Lez, une enquête thématique départementale a été lancée en 2023. Elle porte sur l’étude des « roues élévatoires, puits à roue et norias » des départements du Gard et de l’Hérault (Lisa Caliste, Julia Desagher).
L’étude du patrimoine de la ligne des Causses, dont le tronçon Béziers-Ceilhes est situé sur le département de l’Hérault, est en cours (débutée fin 2019). Elle est réalisée en association avec Philippe Marassé, spécialiste de l’histoire ferroviaire en Occitanie. 59 dossiers ont été constitués et seront prochainement mis en ligne.
Le recensement des œuvres du 1% artistique engagé dans le département en 2023 a pour l'instant permis de localiser 30 œuvres tant dans les écoles primaires, les collèges que les lycées. Seuls 10 sont pour l'instant en ligne. La même année, les données du "plan objet", coordonné par la Direction régionale des Affaires Culturelles d'Occitanie, sur les communautés de communes Sud-Hérault et du Clermontais sont intégrées après vérification.