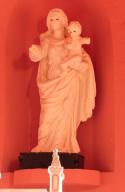L'église a été construite sur un site en bordure de l'Ariège dont l'occupation humaine est attestée depuis au moins l'époque gallo-romaine, comme en témoignent les éléments de céramique que l'on peut encore retrouver in situ. L'église pourrait avoir été fondée sur un site religieux antique. L'analyse archéologique et architecturale des élévations de l'édifice, et en particulier de l'élévation nord de la nef et de l'abside du choeur montre une mise en oeuvre et un appareillage de matériaux propre aux édifices religieux construits au cours du 1er quart ou de la 1ère moitié du 12e siècle sur le territoire appaméen. Cette mise en oeuvre très rare du galet en opus spicatum se retrouve dans des édifices datables des années 1110-1120 comme l'église du Mas-Vieux à Pamiers, l'église du cimetière de Saint-Jean-du-Falga ou celle du Carlaret. L'élévation nord de la nef, avec cette porte à encadrement au couvrement en plein cintre aujourd'hui obturée (porte du cimetière ?), montre plusieurs phases de construction avec un appareil en moellon calcaire et grès dans les parties inférieures qui se différencie de celui employé dans les parties hautes. Il semble y avoir eu surélévation ou reprise des parties hautes avec l'emploi de pierres de taille calcaire dans les deux tiers inférieur puis de moellons de galet, briques et rognons de pierre de taille dans le tiers supérieur. Cette surélévation ou reprise de la nef est très lisible dans les deux tiers inférieurs de l'élévation nord de la nef. Au-delà de la porte obturée, un autre appareillage en pierre de taille et galet apparaît, indiquant que cet édifice antérieur a été agrandi à une date postérieure. L'abside du choeur comporte également partiellement un appareillage en pierre de taille et un appareillage en galet et pierre de taille. Le portail occidental avec son double rouleau en brique chanfreiné pourrait dater du 13e siècle, tout comme la façade occidentale. L'église a sans doute été reprise et agrandie au 17e siècle, en témoignent les encadrement en brique des baies et l'appareillage en brique des autres élévations. Ce type d'encadrement en brique se retrouve sur les églises de Bonnac et de La Bastide-de-Lordat, respectivement reprise et construite au cours du 17e siècle. Au 17e siècle appartient l'ouverture latérale de l'élévation sud de la nef, également caractéristique du repercement de certaines portes dans les églises appaméennes (Bonnac, Le Carlaret ou Les Pujols) et la génoise. Le décor de stuc du choeur et de l'arc triomphal pourrait dater de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. Il est fait mention de travaux au clocher en 1873 par l'architecte diocésain Pierre Izac, il s'agit de la surélévation du clocher et du rejointoiement des briques au mortier. La sacristie attenante pourrait dater de cette période.
- inventaire topographique
-
Peiré Jean-FrançoisPeiré Jean-FrançoisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.
- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers
Dossier non géolocalisé
-
Aire d'étude et canton
Communauté de communes du Pays de Pamiers - Pamiers-ouest
-
Commune
Bézac
-
Lieu-dit
Gaillac
-
Cadastre
1981
C
150
-
Dénominationséglise paroissiale
-
VocablesSaint-Pierre-aux-Liens
-
Parties constituantes non étudiéescimetière
-
Période(s)
- Principale : 1ère moitié 12e siècle
- Principale : 13e siècle
- Principale : 17e siècle
- Principale : 19e siècle
- Secondaire : 2e quart 19e siècle
-
Dates
- 1873, daté par source
-
Auteur(s)
- Auteur : architecte diocésain attribution par source
L'élévation nord de la nef comporte un appareillage superposé de pierres de taille calcaires, de moellons calcaires et grès puis de galets partiellement enduits. L'abside reprend en partie cet appareillage. L'élévation sud comporte également un appareillage de briques concassées. Une génoise en brique à plusieurs assises de tuiles fait le tour des élévations de la nef et du choeur. La façade occidentale est en moellon, brique et enduit. Les baies du choeur et de la nef comportent un encadrement en brique ou pierre de taille calcaire. L'édifice ne présente qu'un seul vaisseau, avec une sacristie attenante au sud. La sacristie est couverte d'un appentis, la nef d'un toit à longs pans et l'abside d'une croupe polygonale, l'ensemble étant recouvert de tuiles creuses mécaniques. Le clocher est en brique rejointoyée au mortier. La nef et le choeur comportent un plafond en berceau à lattes de bois.
-
Murs
- grès
- poudingue
- brique
- enduit
- galet
- moellon
- pierre de taille
-
Toitstuile creuse mécanique
-
Plansplan allongé
-
Étages1 vaisseau
-
Couvrements
- charpente en bois apparente
-
Couvertures
- toit à longs pans
- appentis
- pignon couvert
- croupe polygonale
-
Typologiesclocher-mur
-
Techniques
- menuiserie
- décor stuqué
- décor stuqué
-
Représentations
- colonne
- ordre ionique
-
Précision représentations
Arc triomphal du choeur : décor de stuc formé de colonnes à ordre ionique supportant un entablement.
Champs annexes au dossier - Architecture
- NOTB_G
- NOTB_S
- APPA
- APRO
- ARCHEO
- AVIS
- CCOM
- CHARP
- CHARPP
- COORLB93 0585112 ; 6229297
- COORMLB93
- COORMWGS84
- COORWGS84 43.1536847692019, 1.58848735709067
- ENCA
- EPID
- ESSENT
- ETACT
- FEN
- FEN2
- FENP
- INTER
- MHPP
- NOPC
- OBSV
- PAVIS
- PETA_MA
- PLU
- PSAV_FA
- SAV_FA
- SELECT oeuvre sélectionnée
- TAILL
- TAILLP
- TOITU
- USER IVR73_SCPMIDIPYR
- VALID accessible au grand public
- VISI
- VISIB
- VOIR_AUSSI
- Bézac
- 20220315_R_01
-
Statut de la propriétépropriété de la commune
-
Intérêt de l'œuvreà signaler

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers

- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers
- (c) Inventaire général Région Occitanie
- (c) Communauté de communes du Pays de Pamiers